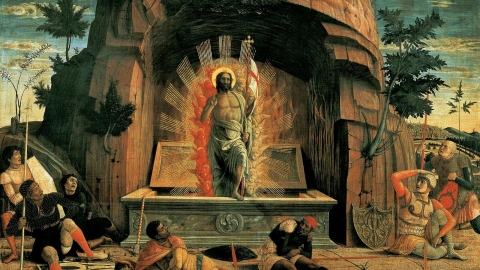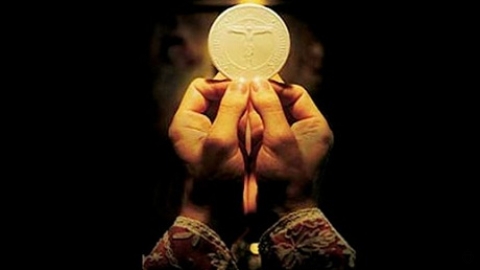La mission auprès des Yanomami d'Amazonie : une débâcle et une trahison
FSSPX.Actualités publie un article paru le 14 mars 2019 sur le site panamazonsynodwatch. Rédigé par José Antonio Ureta, un laïc chilien membre de l’association Fundación Roma, il présente l’état déplorable d’une mission auprès des Indiens Yanomamis, au nord du Brésil. Les lignes qui suivent décrivent le naufrage spirituel d’une mission qui n’a plus rien de catholique. Elles illustrent la dérive actuelle d’une Eglise qui ne cherche plus à convertir, mais à se convertir au monde, par le dialogue et l’inculturation, quitte à abandonner les âmes aux esprits chamaniques et au paganisme le plus grossier.
Depuis 1965, l'Institut de la Consolata des Missions Etrangères, originaire de Turin et présent dans 28 pays, assure une mission parmi les Yanomamis au Brésil. La mission est actuellement dirigée par le prêtre italien Corrado Dalmolego, assisté de trois religieuses de la branche féminine de l'Institut.
Dans une récente interview au portail Internet Periodista Digital, le missionnaire de la Consolata a fourni des détails intéressants sur sa conception de la mission et de ses activités apostoliques, avançant que son exemple pourrait servir de modèle pour le prochain Synode panamazonien du Vatican, en octobre. Ses déclarations étonnantes ont été approuvées par un autre missionnaire, le père Luis Miguel Modino, prêtre madrilène, qui exerce son ministère dans le diocèse de São Gabriel da Cachoeira, dans l’Etat de l’Amazonas (Brésil).
Pour comprendre la signification des opinions exprimées par le père Dalmolego, il faut connaître la culture yanomami, dans laquelle il exerce son activité missionnaire.
Une vie tribale
Les Yanomamis sont un groupe ethnique composé de 20 à 30 000 indigènes qui mènent une vie primitive dans la forêt tropicale. Ils vivent dans le bassin de la rivière Mavaca, le long des affluents de l'Orénoque, ainsi que dans la chaîne de montagnes de Parima. Cette région chevauche le sud du Venezuela et les Etats brésiliens d'Amazonas et de Roraima. La Mission Catrimani des Missionnaires de la Consolata est située au bord du fleuve du même nom.
Les indigènes vivent dans de petits villages de 40 à 50 personnes. En fait, il s'agit plutôt de nomades qui chassent à l'arc et à la flèche et cultivent des terres durant deux ou trois ans. Quand la terre est épuisée, les villageois vont planter ailleurs leur habitat rudimentaire.
Leurs vêtements se réduisent à quelques ornements aux poignets et aux chevilles, et à un simple ruban autour de leur taille. Les hommes de la tribu sont polygames à partir de l’adolescence. Ils consomment régulièrement, sous forme de poudre, une plante appelée "Epená" ou virole, qui est une substance hallucinogène. Les chamans l'utilisent aussi dans les rituels de guérison comme un moyen d'identifier une maladie en communiquant avec les esprits.
La santé est le plus gros problème que doivent affronter les Yanomamis, victimes des maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme. Celui-ci est la principale cause de décès chez eux, ainsi que l'hépatite, la diarrhée et la tuberculose. Les maladies respiratoires telles que la pneumonie et la bronchite sont fréquentes, et se répètent chaque année. L’absence de soins dentaires – ils ne se nettoient jamais les dents – entraîne également des problèmes sanitaires chroniques.
L’infanticide, une tradition culturelle
L’infanticide est une "tradition" profondément enracinée chez les Yanomami. C’est la mère qui l’accomplit lorsqu'elle s'éloigne pour accoucher. Elle peut alors soit accueillir son nouveau-né, soit tuer l'enfant en l'enterrant vivant.
L'infanticide est pratiqué non seulement pour éliminer les enfants nés avec des malformations, mais aussi pour sélectionner le sexe du nouveau-né, les garçons étant notamment préférés comme premiers-nés. Si des jumeaux naissent, un seul est autorisé à vivre. Si les deux sont des mâles, le plus faible est tué.
Ces meurtres sont simplement commis pour éviter d’avoir à s'occuper de deux nourrissons en même temps, car les enfants allaitent pendant trois ans en moyenne.
Retour en barbarie
Les Yanomami ont un caractère hautain et guerrier. Quand les guerriers tuent, ils acquièrent le statut social d'unokai. Ceux qui tuent plus d'ennemis acquièrent plus de prestige et plus de femmes. Pour attaquer les villages d'autres tribus, ils forment des alliances avec des étrangers plutôt qu'avec des proches parents. Le butin de guerre leur permet d’épouser les sœurs ou les filles de leurs alliés.
Une coutume primitive de ce groupe ethnique est le cannibalisme rituel. Lors d'un service funéraire collectif et sacré, ils incinèrent le corps d'un parent mort pour en manger les cendres des os, qui sont mélangées à de la pâte "pijiguao", confectionnée à partir du fruit d'une sorte de palmier. Ils croient que l'énergie vitale du défunt réside dans les os et qu’elle peut être ainsi réintégrée dans le groupe familial. Un Yanomami qui tue un adversaire en territoire ennemi pratique aussi cette forme de cannibalisme pour se purifier.
On l’aura compris, les Yanomami sont loin de répondre aux normes du "bon sauvage" de Jean-Jacques Rousseau…
Des missionnaires à l’école du paganisme syncrétiste
Le père Corrado Dalmonego vit à Catrimani depuis 11 ans. Bon connaisseur des Yanomami, il résume son attitude envers leurs croyances religieuses comme le partage d’une culture qui vit « l'expérience de sa propre religiosité et spiritualité ». Le père Dalmonego croit que ces sauvages peuvent « même aider l'Eglise à se purifier des schémas, des structures mentales qui sont peut-être devenues obsolètes ou inadéquates ».
En premier lieu, le père Dalmonego pense que les Yanomami peuvent aider l'Eglise à « défendre ce monde » et à « construire une écologie intégrale » en « établissant des ponts entre les connaissances traditionnelles et les connaissances modernes et écologiques de la société occidentale ».
De plus, l'Eglise s'enrichit grâce à eux « de recherches sur le chamanisme, les mythologies, les différentes connaissances, les visions du monde, les visions de Dieu ». A travers des moments forts de dialogue, les peuples autochtones aident les missionnaires à « découvrir l'essence de notre foi, souvent déguisée par des ornements et des traditions culturelles ».
Enfin, le père Dalmonego explique qu’une forme d'enrichissement spirituel est fournie par la capacité des Yanomami à « tendre à mettre les choses ensemble », c'est-à-dire qu'ils peuvent invoquer le Dieu des Blancs sans renoncer à leurs propres croyances : « ils ne les abandonnent pas, mais s'approprient quelque chose d'autre. Pourquoi ne le ferais-tu pas aussi en tant qu'Eglise ? », s’interroge le missionnaire de la Consolata. « D'un côté, on peut parler de syncrétisme ou de relativisme », reconnaît-il, avant de conclure que « la vérité ne nous appartient pas ».
L’anthropologue a trahi le missionnaire
Cette nouvelle conception réduit l'action évangélisatrice de l'Eglise à un simple exercice de dialogue interreligieux. Le père Dalmonego se vante d'un fait étonnant que tout missionnaire normalement constitué considérerait comme un échec des plus amers. Il célèbre le fait qu'il est le directeur d'une « mission de présence et de dialogue » dans laquelle personne n'a été baptisé depuis 53 ans !
C'est même la raison pour laquelle la mission Catrimani pourra servir de référence pour le Synode pan-amazonien du Vatican en octobre, car elle est considérée comme « une présence prophétique pour l'Eglise, à l'écoute des peuples ».
De tels missionnaires ne se soucient apparemment plus du mandat du Christ d'aller évangéliser tous les peuples « en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19). Non seulement ils ne l’accomplissent pas, mais ils assument cette situation en la justifiant. Ils font leurs ces paroles de David Kopenawa, un dirigeant yanomami, qui affirme que la mission Catrimani a raison de ne pas contester la culture yanomami ni de condamner le chamanisme.
En conséquence, le missionnaire italien croit que le prochain Synode est très important, qu’il sera un moyen de faire connaître le message de Yanomami, au moment où l'attention de tous sera fixée sur l'Amazonie.
Une nouvelle voie pour toute l’Eglise !
Ces théories semblent tout à fait en phase avec les projets des organisateurs du Synode. Le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, a déclaré lors de la conférence de presse qui présentait le Document préparatoire à l'Assemblée spéciale d'octobre prochain que son objectif est « de trouver de nouvelles voies pastorales pour une Eglise à visage amazonien, avec une dimension prophétique dans la recherche de ministères et de lignes d'action plus appropriées dans un contexte de véritable écologie intégrale » (sic).
Conscient du caractère plutôt énigmatique de sa déclaration, le cardinal Baldisseri a ajouté : « C'est le pape François qui nous montre le chemin pour comprendre l'expression "visage amazonien". En effet, à Puerto Maldonado, il a dit : "Nous qui n'habitons pas ces terres, nous avons besoin de votre sagesse et de votre savoir pour y entrer, sans détruire le trésor qui entoure cette région, faisant écho aux paroles du Seigneur à Moïse : "Enlevez vos sandales, car la terre que vous foulez est sainte" (Ex 3, 5) ».
Le cardinal Baldisseri poursuit : « Comme l'a dit le pape François, la tâche de la nouvelle évangélisation des cultures traditionnelles vivant en Amazonie et dans d'autres territoires exige de prêter aux pauvres "notre voix à leurs causes, mais aussi d'être leurs amis, de les écouter, de parler pour eux et d'embrasser la sagesse mystérieuse que Dieu veut partager avec nous par eux" (Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n°198) ».
Lorsque les esprits infernaux font bon ménage avec l’écologie
Plus spécifiquement, cette communication avec Dieu se fait à travers les chamans. Dans sa sous-section intitulée "Spiritualité et Sagesse", le document préparatoire du Synode affirme que « les diverses spiritualités et croyances » des peuples autochtones « les motivent à vivre en communion avec la terre, l'eau, les arbres, les animaux, le jour et la nuit » et que « les sages, appelés sans distinction sorciers, maîtres, Wayanga ou chamans, entre autres, favorisent l'harmonie entre eux et avec le cosmos ».
Le soin de l'environnement, affirme encore le document, est l'un des principaux domaines où cet apprentissage ecclésial doit être réalisé : « La conversion écologique consiste à assumer la mystique de l’interconnexion et de l’interdépendance de toute la création… C’est quelque chose que les cultures occidentales peuvent et même devraient apprendre des cultures traditionnelles amazoniennes et d’autres territoires et communautés de la planète. Ces peuples “ont beaucoup à nous enseigner” (EG 198). Grâce à leur amour de la terre et à leur relation avec les écosystèmes, ils connaissent le Dieu Créateur, source de vie… C’est pourquoi le Pape François a souligné qu’il “est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux” et par leurs cultures ».
Les missionnaires religieux de la Consolata de la Mission Catrimani peuvent dormir en paix. Le pape François ne leur reprochera pas de ne pas avoir baptisé de Yanomami en 53 ans. Peut-être devraient-ils devenir apprentis chamans et suivre un cours sur les rituels Yanomami de David Kopenawa…
José Antonio Ureta
(Source : panamazonsynodwatch.info/FSSPX - FSSPX.Actualités - 07/11/2019)