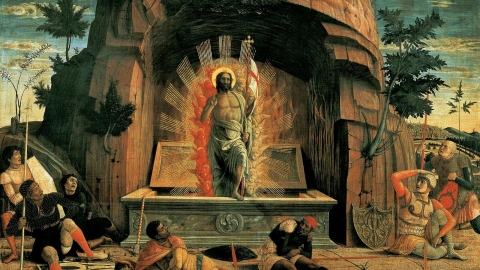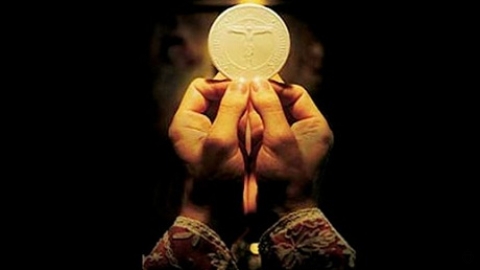Consécration à saint Joseph

Consécration à Saint Joseph, Abbé Roger Guéguen, Convictions 26, mars 2013
Extrait des archives de Convictions
Consécration à saint Joseph
Patron du Canada
C’est aux premiers missionnaires de la Nouvelle-France, les Récollets, que revient l’honneur d’avoir choisi, par un vœu public fait à Québec le 19 mars 1624, et auquel s’associèrent tous les habitants, saint Joseph « pour patron du pays et le protecteur de cette Église naissante. » (1) Ainsi commence le mandement de son Éminence le Cardinal Bégin, archevêque de Québec, à l’occasion du troisième centenaire du Patronage de saint Joseph au Canada, en 1924. Ce que confirme le père Henri-Paul Bergeron, c.s.c. (Congrégation de la Sainte Croix), dans l’une des publications du Centre de recherche de L’Oratoire Saint-Joseph (2) : « La tradition de la dévotion à saint Joseph remonte d’ailleurs au tout début de notre pays qui lui fut officiellement consacré en 1624. » Et de continuer : « Les Relations des Jésuites nous révèlent à quel point ce culte était populaire en Nouvelle-France. C’est sous son patronage que s’accomplit l’évangélisation des Indiens et c’est le nom que l’on donnait habituellement aux nouveaux convertis. La coutume s’établit rapidement et s’est conservée jusqu’à nos jours de choisir le nom de Joseph comme premier patronyme au baptême. L’étude des mandements des évêques du Québec manifeste aussi que l’encouragement de la dévotion à saint Joseph est une constante de notre histoire. »
Gloire au missionnaire Joseph Le Caron, à qui l’on doit le choix de saint Joseph comme premier patron de la Nouvelle-France ! Ce Récollet arrive à Québec en 1615, célèbre la première messe chez les Hurons le 12 août 1615, rentre en France l’année suivante, revient en 1617 pour exercer son ministère à Tadoussac avant de reprendre en 1623 le chemin pour retrouver ses Hurons. Le père Le Caron rédige alors un mémoire sur les mœurs des Hurons et les difficultés des travaux d’évangélisation. Voici ce qu’il note pour le 19 mars 1624 : « Nous avons fait une grande solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs sauvages, par un vœu que nous avons fait à saint Joseph, que nous avons choisi pour notre patron du pays et protecteur de cette église naissante. » (3)
Le Saint-Esprit, inspirateur du geste des Récollets, va désormais susciter les Jésuites qui à la suite de Charles Lalemant, Jean de Brébeuf, Ennemond Massé, Anne de Nouë, pour ne citer que les plus connus, vont endosser pleinement la consécration de 1624 : les premiers baptêmes d’Indiens qui reçoivent le glorieux patronyme du protecteur du Canada, le vœu de 1635 du Père Le Jeune, la fête patronale du 19 mars à partir de 1637. Mentionnons également le titre de nouveau patriarche des Hurons que Jean de Brébeuf décerne à saint Joseph (4) , le premier baptisé iroquois du nom de Joseph (5) ainsi que la Résidence de Saint-Joseph ou Sillery (6) . Et c’est la raison pour laquelle le Père Debarry écrivait, il y a déjà longtemps : « Il n’est point d’endroit au monde où la fête de saint Joseph se célèbre avec plus de pompe et de réjouissance qu’au Canada ; c’est le père, le patron et le protecteur de cette nouvelle France, et c’est pour cela que sa fête est une des grandes solennités du pays. Dans la relation de ce qui se passa en cette contrée l’an 1637, il est dit que, la veille de la fête de ce glorieux Patriarche, on arbora à Québec le drapeau français sur un bastion au bruit du canon ; le gouverneur de la place fit faire des feux de joie et d’artifice comme on n’en avait pas encore vu en ce pays, ce qui faisait dire aux sauvages étonnés qu’il fallait que saint Joseph fût quelque grand et signalé personnage, puisqu’à son occasion, et pour lui rendre honneur, on changeait en jour la pleine nuit par tant de feux. Le lendemain, qui était le jour de sa fête, ce ne fut que dévotion dans l’église ; tout le monde y fut et s’y comporta comme en un jour de Pâques, chacun bénissant Dieu d’avoir donné pour protecteur à la Nouvelle France celui qui avait été durant sa vie le protecteur et comme l’ange gardien du Verbe incarné. » (7)
Marie de l’Incarnation
Voici le tour de Marie de l’Incarnation : « Un jour que j’étais en oraison devant le saint Sacrement, je traitais pour lors avec elle (la divine Majesté) du salut des âmes, dans l’accès ordinaire auquel il lui plaisait de m’attirer… Lors, l’âme, piquée dans les intérêts de l’Epoux, le sacré Verbe incarné, par une amoureuse impatience, voulait que ses affaires fussent avancées, et qu’elle fût victime, bien qu’il fallût donner mille vies, s’il lui eût été possible, pour ce sujet ; et qu’il plût au Père Eternel de la mettre en état de pouvoir exécuter le commandement qu’il lui avait fait de lui faire une maison en Canada, en laquelle il fût loué et adoré avec Jésus et Marie et qu’il n’en séparât point le grand saint Joseph.
C’est que j’ai eu de fortes impressions que ç’avait été celui que j’avais vu être le gardien de ce grand pays, et dans mes plus intimes et familiers entretiens j’avais en l’esprit que Jésus, Marie et Joseph ne devaient point être séparés, en sorte qu’une fois, étant à table, au réfectoire, pâtissant des affections extatiques, je disais : « O mon Amour, il faut que cette maison soit pour Jésus, Marie et Joseph », ne pouvant faire autrement. J’avais une certitude que la divine Majesté agréerait mes instances, que je ne faisais que par la motion de son Saint-Esprit… » (8) (Article 42)
« Ce fut le 22e de janvier 1639, jour des Epousailles de la très sainte Vierge et de saint Joseph, que nous reçûmes (à Tours) cette nouvelle (de l’aboutissement prochain des dé- marches de madame de la Peltrie), et que notre Révérende Mère (prieure) déclara tout le secret à notre communauté, lorsque toutes étaient dans un ermitage (9) de Saint-Joseph, à faire des dévotions pour la solennité de ce jour. Je ne m’y trouvai pas à dessein, et aussi parce que je servais ce jour-là à la cuisine...
Madame de la Peltrie ayant expédié ses affaires, elle partit de Paris avec Monsieur de Bernières pour venir à Tours. Le jour que nous devions recevoir les lettres annonçant son départ, le matin, étant aux pensionnaires, desquelles j’avais soin, j’eus un instinct dans mon âme qui me disait que je quittasse tout et que je m’en allasse dans l’ermitage de Saint-Joseph, pour le remercier d’une grandes grâce qu’il m’avait faite (et dont elle avait le pressentiment)… Environ une heure après, ma Mère Ursule de Sainte-Catherine me vint trouver et me dire : « Ah ! ma chère sœur, que Dieu vous fait de grâces ! Cette Dame vous vient quérir ; elle va bientôt arriver. » … Ayant appris cette nouvelle, je ne doutais plus du sujet pour lequel j’avais été si fortement portée d’aller remercier le grand saint Joseph, à qui le séminaire devait être dédié… » (Article 45)
Pour la petite histoire, le 4 mai suivant, avec le Père Barthélemi Vimont qui allait prendre charge de la mission, et un frère coadjuteur, son compagnon, avec trois Hospitalières de Dieppe qui devaient fonder l’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, et deux jeunes filles séculières à leur service, madame Madeleine de Chauvigny de la Peltrie et ses trois Ursulines – Mère Cécile de Sainte-Croix s’était jointe aux deux autres, à Dieppe – prenaient la mer sur le SaintJoseph, pour aller commencer le séminaire de Saint-Joseph, en un pays dont saint Joseph était reconnu, au ciel et sur terre, le gardien fidèle. (10)
Fondation de Ville-Marie
Venons-en maintenant à la fondation de Ville-Marie (Montréal), à partir du témoignage suivant : « Le vingthuitième de juillet, une petite escouade d’Algonquins, passant en ce quartier-là, s’y arrêtèrent quelques jours. Un capitaine présenta son fils au baptême, âgé d’environ quatre ans. Le Père Joseph Poncet le fit chrétien, et le sieur de Maisonneuve et mademoiselle Mance le nommèrent Joseph, au nom de Messieurs et de Mesdames de Notre-Dame de Montréal. Voilà le premier fruit que cette île a porté pour le Paradis ; ce ne sera pas le dernier… » (11)
Marie-Catherine-Joseph de Saint-Augustin manifeste elle aussi une grande dévotion à saint Joseph. Totalement consacrée à la sainte Vierge, le 8 septembre 1642, par une donation signée de son sang, Catherine, « en 1643, le jour de saint Joseph, se mit de l’Association de la Sainte Famille de Jésus, pour obtenir la grâce de bien mourir ». Elle avait onze ans. (12)
Renouvelant sa donation à Marie, le 25 mars 1648, peu de temps avant son départ pour le Canada, elle en prend à témoin « votre glorieux époux saint Joseph ».(13)
Fortement tentée de retourner en France, elle prononce, le 18 octobre 1654, un vœu de stabilité, qu’elle offre à Dieu en présence de la sainte Vierge et « de son glorieux Époux ».
Terminons à ce sujet par les communications intérieures dont Mère Catherine fut favorisée à l’occasion de la fête du patron du Canada. « La veille du glorieux saint Joseph, environ à neuf heures et demie du soir, je me trouvai comme enlevée dans un lieu spacieux. Là, il me sembla voir saint Joseph, le Père de Brébeuf et le Père Gabriel Lalemant. Chacun avait deux anges qui les avaient accompagnés pendant leur vie, à cause de la mission apostolique et du martyre où Dieu les avait destinés. Saint Joseph, s’adressant au Père de Brébeuf, lui demandait ce qu’il me donnerait le jour de la fête, pour le soin que je prenais d’un pays qui lui appartenait. Le Père semblait le pousser à continuer et effectuer la bonne volonté qu’il avait pour moi. Et il me sembla que tous deux me demandaient ce que je voulais. Je m’excusai de rien demander et ne voulais du tout adhérer à leurs désirs. Ils me pressaient, mais j’étais dans la crainte de faire quelque réponse qui fût contraire au dessein de Dieu. Enfin, étant obligée par le Saint et par le Père de demander ce que je voudrais pour moi et pour les autres, je les priai de donner au pays ce qu’ils connaissaient y être pour le mieux, et à moi selon que Dieu l’agréerait davantage. On n’accepta pas une demande si générale pour mon égard et le Saint voulut que je nommasse en particulier ce que je désirais, m’offrant la délivrance des démons, si je le voulais. A quoi je n’acquiesçai point, ayant comme une assurance que ce n’était pas le meilleur pour moi. Je voulais que ce grand Saint me donnât selon ce qu’il verrait de plus expédient pour mon bien. Mais absolument il voulut que je fisse choix moi-même. De sorte qu’étant pressée de faire ma demande, je le suppliai de m’obtenir de Dieu une rémission entière de mes péchés, en sorte que mon âme fût totalement purifiée de toutes les souillures que le péché y avait faites jusqu’à maintenant, et qu’à l’avenir je ne fusse plus si infidèle à Dieu que de l’offenser non seulement grièvement mais même véniellement. Au même temps, il me sembla que j’étais purifiée de tous les péchés et que mon âme était ornée d’une grâce admirable, qui la rendait très agréable à Dieu. Et il me sembla que saint Joseph fit intervenir la sainte Vierge, pour me montrer à elle en cet état. Elle m’en témoigna grande satisfaction encore pour d’autres, qu’ils eussent pareille grâce et surtout qu’ils fussent comme confirmés pour l’avenir. On me l’accorda pour quelques-uns qu’on me nomma. Cette vue, ou plutôt cette assurance de la présence de ces saints, se dissipa et me laissa, toute la nuit et le jour suivant, dans de très grandes reconnaissances et beaucoup de paix intérieure. Il me serait difficile d’exprimer la consolation que je ressentais, quoiqu’elle ne fût pas d’une manière sensible. » (14)
Les évêques du Québec
Il faut encore souligner la fin des instructions de Mgr de Laval qu’il adresse à l’abbé François de Salignac de Lamothe-Fénelon, prêtre de Saint-Sulpice, qui doit accompagner l’abbé Claude Trouvé, son confrère, pour une mission d’hiver auprès des Iroquois des bords du lac Ontario ; implorant sur eux les bénédictions de « Notre-Seigneur Jésus-Christ, le souverain Pasteur des âmes », il conclut : « Nous le supplions très humblement par ses mérites, par l’intercession de sa très sainte Mère, du bienheureux Saint Joseph, Patron spécial de cette Eglise naissante, de tous les SS. Anges tutélaires des âmes qui sont sous notre charge et de tous les saints Protecteurs de tout ce christianisme. » (15)
Son successeur, Mgr de Saint-Vallier, publie les Statuts du premier synode, tenu à Québec le 9 novembre 1690. Il assigne à la fête de saint Joseph la seconde des trois indulgences plénières que le Saint-Siège lui a permis d’accorder à ses diocésains. (16) Et le premier Rituel du diocèse de Québec, en 1703, classera officiellement parmi les « festes immobiles », celles de « Saint Joseph, premier Patron du Païs » et de l’Annonciation, avec la remarque suivante : « Ces deux Festes sont remises au Lundy lorsqu’elles arrivent le Dimanche ; & elles sont transférées après Pâques lorsqu’elles arrivent pendant la Semaine Sainte. Elles sont toujours chômées. » (17)
Le régime protestant britannique
On ne peut passer sous silence la période la plus douloureuse de l’histoire du Canada, à savoir sous le régime protestant britannique. Les documents épiscopaux mentionnent toujours saint Joseph comme patron principal du pays, patron principal du diocèse, premier patron de cette contrée : expressions diverses qui se retrouvent dans la collection des Mandements de Mgr Hubert de Québec, 1793, de Mgr Denaut, 1805, et de Mgr Panet, 1830. (18)
Le 4 juin 1854, les Pères du 2e concile de Québec, à savoir l’archevêque de Québec, l’évêque de Montréal, l’Administrateur apostolique de Kingston et les évêques de Saint-Hyacinthe, Bytown (Ottawa), Toronto et Trois-Rivières, demandent la permission d’ajouter la commémoration de saint Joseph à la messe des épousailles de la B.V. Marie. (19)
En 1876, quand l’épiscopat demande au Saint-Siège de proclamer saint Anne patronne de la province de Québec, on lit la note suivante dans le mandement de l’archevêque de Québec : « sans préjudice, toutefois, au titre que possède depuis 1624 saint Joseph, époux de la Bse Vierge Marie, comme patron du Canada tout entier. » (20)
La tradition de la dévotion à saint Joseph fut commé- morée en 1915, lors du tricentenaire de la foi au Canada. L’Ontario célèbre alors le 3e centenaire de la foi au Canada, à Lafontaine, petite paroisse française dont l’école séparée est dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph. Ce village est situé sur l’emplacement de l’ancienne bourgade huronne où le Récollet Joseph Le Caron célébra la première messe en Ontario, le 12 août 1615, y apportant son ardente dévotion à saint Joseph, son patron. Mgr McNeil, archevêque de Toronto, célébra une messe pontificale sur ce site historique et les Franciscains y prêchèrent dans les deux langues. (21)
Abbé Roger Guéguen
Convictions Numéro 26, mars 2013
Sources:
1. P. Chrétien LECLERCQ, Premier établissement de la foy, I, p. 287 – Les Ursulines de Québec, I, p. 253.
2. Cahier de Joséphologie, Vol. XXIII, no 1 : janvier-février 1975, p. 41
3. http://www.saintjosephduweb.com
4. Relation de 1635, Mission des Hurons, p. 24 B.
5. Relation de 1637, ch. 2, p. 109 B – 119 A.
6. Relation de 1638, ch. 7, p. 17 B – 20 A ; Rel. de 1639, ch. 5, p. 19 B – 27 A ; Rel. de 1640, ch. 3, p. 7 A – 12 A ; etc.
7. Jean-Joseph HUGUET, Le Propagateur de la dévotion à Saint-Joseph et à la Sainte Famille, Périsse, 1876.
8. Dom JAMET, Écrits spirituels et historiques de MARIE DE L’INCARNATION, t. 2, p. 325, note b, nous fournit le renseignement suivant : « Dans une relation qu’elle écrivit plus tard de sa vocation au Canada – on ne sait à quelle date – Marie a fixé cette faveur à l’année 1635 environ. Ce n’est qu’une indication approximative. »
9. On appelle ermitage un lieu de retraite dans un jardin de religieux.
10. Tous les textes qui précèdent sont extraits de l’édition critique de dom Albert JAMET, O.S.B., des Écrits spirituels et historiques de MARIE DE L’INCARNATION, Paris-Québec, 1930, t. 2, p. 303 s.
11. Relation de 1642, ch. 9, p. 37 B – 38 A.
12. Vie de La Mère Catherine de Saint-Augustin, Paris, 1671, réimprimée à Québec en 1923, p. 29.
13. Ibid., p. 34.
14. RAGUENEAU, p. 120-121 ; HUDON, p. 159.
15. Pour les documents officiels de Mgr de LAVAL concernant la Confrérie de la Sainte-Famille, voir les Mandements… des évêques de Québec, Québec, 1887, t. 1, p. 75.
16. Ibid., t.2, p. 42.
17. Rituel du diocèse de Québec, publié par l’ordre de Mgr l’évêque de Québec, Paris, 1703, 673 p. L’ordonnance qui contient cette liste de « festes immobiles » se trouve en tête du Rituel.
18. Recueil d’Ordonnances synodales et épiscopales du diocèse de Québec…, Québec, 1865, p. 167, et Mandements… des évêques du Québec, 1888, t. 2 et 3, ainsi que les actes des deux Conciles provinciaux de Québec de 1851 et 1854, dans Concilia Provinciae Quebecensis, I, II, III, IV…, Québec, 1870, p. 79-80, et 86-87.
19. Concilia Provinciae Quebecensis…, Québec, 1870, Acta et decreta secundi, p. 85.
20. Mandements… des évêques de Québec, t. 6, Québec, 1890, p. 36- 37.
21. Le 3e centenaire de l’établissement de la foi au Canada, Volume-Souvenir édité par le P. Odoric M. JOUVE, O.F.M., (Québec), 1917, p. 257-266.